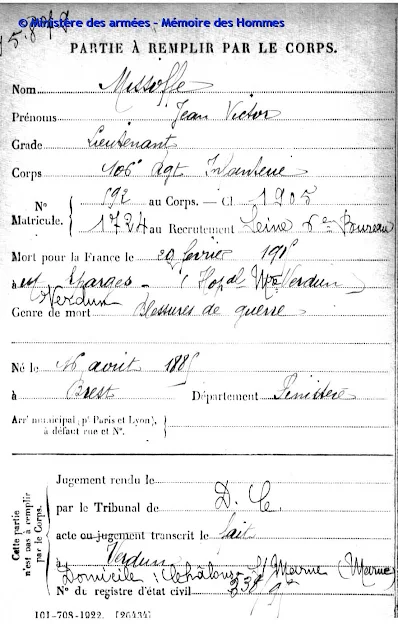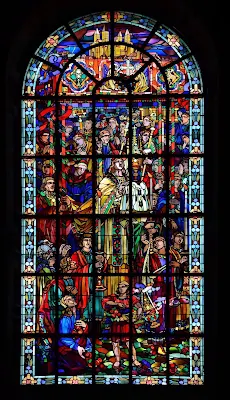En 1922, le Souvenir français décida de rendre hommage, sur le champ de bataille, aux soldats des 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied et à leur chef le lieutenant-colonel Driant.
 |
| Le monument en hommage au Lt-colonel Driant et à ses chasseurs |
L’inauguration du monument le 22 octobre 1922
[Source : L’Écho de l’Ossuaire de Douaumont et des champs de bataille de Verdun - Gallica]
Au Bois des Caures, on honorait le colonel Driant et ses chasseurs. Tout près de l'endroit où il tomba mortellement frappé, et au bord de la route qui traverse le. Bois des Caures, un sculpteur, Grégoire Calvet, a taillé dans la pierre, tirée dés carrières de Rupt-en-Woëvre. Une forêt de petites croix se détache dans un flou voulu : leurs formes idéalisées viennent aboutir à une croix beaucoup plus grande, dont les bras semblent barrer l'horizon d'un obstacle infranchissable. Une main s'élève sur le fût supérieur de la croix, comme pour repousser l'envahisseur, même par delà la mort. Au-dessus, est gravée l'inscription : « On ne passe pas ! »
Tout en haut du fût se profile la silhouette des avancées de Verdun sauvé. Sur le socle, se lit cette inscription : « Au colonel Driant et à ses Chasseurs ». Enfin, devant le monument, une simple dalle de pierre indique l’endroit ou est inhumé le corps du brave colonel et les onze Chasseurs, non identifiés, retrouvés dans ce secteur. Le vœu du grand chef se trouve réalisé; il repose près de ses Chasseurs !
 |
| Grégoire Calvet sculptant le monument dans les carrières de Rupt-en-Woëvre |

Il est 2 h, et, en présence d'une foule nombreuse, entourée des ministres, généraux et parlementaires, commence la cérémonie d'inauguration du monument. Devant le monument, les fanions des bataillons sont rangés, ainsi que la fanfare du 16e bataillon, devant la croix de pierre a été placé le drapeau des Chasseurs à pied venu de Grenoble.
 |
| La foule et les porte-drapeaux devant le monument le 22 octobre 1922. |
M. Maginot prend le premier la parole. Il lit, en commençant, un télégramme d'excuse de M. Polncaré, qui n'a pu quitter Paris, mais qui assure Mme Driant et ses vaillants camarades les Chasseurs à pied, qu'il est de cœur avec eux ». Après avoir dit que le colonel Driant, digne successeur des Roland, Jean le Bon, Bayard, Chevert, d'Assas, Beaurepaire, etc. a été une des plus nobles émanations de cette âme française à laquelle notre pays doit sa force et son rayonnement. le ministre évoque la jeunesse studieuse du héros, sa carrière d'officier, succès dans la politique, enfin, sa conduite héroïque pendant la guerre. […]
 |
| De gauche à droite : G. Bègue (préfet de la Meuse) A. Maginot, E. de Castelnau |
 |
| Émile Driant (11 septembre 1855 - 22 février 1916) |
Suivront des discours du général de Castelnau, de Victor Schleiter, président du Souvenir français (futur député de la Meuse et maire de Verdun), Désiré Ferry, député de Meurthe-et-Moselle, de l’académicien Maurice Barrés qui salue l’œuvre littéraire de Driant, du sénateur François Marsal et enfin de Mgr Ruch, évêque de Strasbourg qui vient fermer la série des discours. Ceux-ci terminés, la fanfare joue la Sidi-Brahim et le général Boichut fait rendre les honneurs au glorieux drapeau des Chasseurs de Driant. Avant les discours, le monument avait été béni par Mgr de la Celle, évêque de Nancy, et une absoute donnée par Mgr Ginisty, évêque de Verdun.
Source des photos d’archives : Gallica
 |
| Réédition en 2016 du timbre de 1956 : "COLONEL DRIANT 1855-1916" |
 |

Le monument 100 ans plus tard |